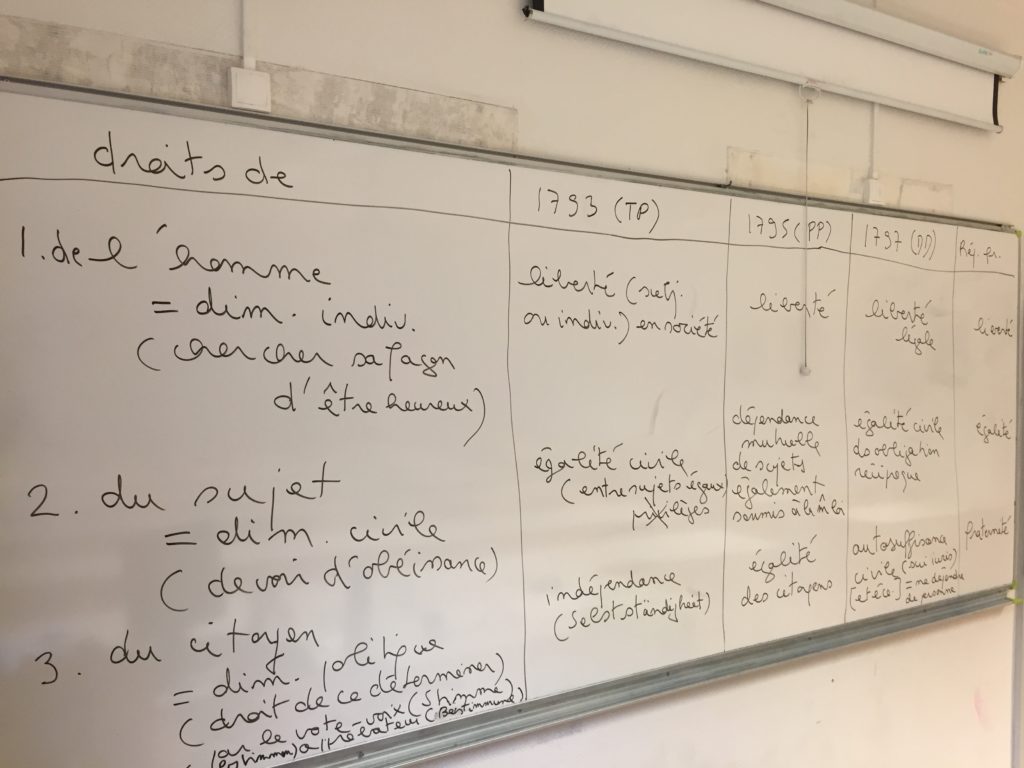Cours audio sur la philosophie politique de Kant
cours confiné (avril 2021)
Lecture cursive de l’appendice à la Paix perpétuelle (1795-1796)
Cette lecture fait suite à plusieurs cours anciennement professés, dont le programme précise la problématique qui s’inscrit dans le sillage des ouvrages et autres articles publiés sur la politique de Kant. Il s’agit, pour l’essentiel, de montrer que la politique est le lieu d’une articulation entre droit et histoire qui contraint à penser la tension entre théorie et pratique: ce qui a poussé Kant à esquisser les linéaments d’un réformisme révolutionnaire dont il faudrait, à l’heure actuelle, tirer un enseignement…
I. De l’incompatibilité prétendue
entre morale et politique
Au début du premier appendice à la Paix perpétuelle (1795), Kant prend soin d’énoncer deux thèses, qui vont s’avérer décisives pour la suite.
Premièrement, la politique est une doctrine du droit en acte qui a pour fin de réaliser en pratique la théorie du droit :
« il n’y a donc aucun conflit entre la politique, en tant que doctrine appliquant le droit, et la morale, en tant que cette même doctrine, mais théorique » (VIII,370 11-12)[1].
Deuxièmement, l’institution empirique du droit est, en contradiction avec l’idée même du droit, le fait de la violence :
« dans la réalisation de cette idée (dans la pratique), il ne faut compter sur aucun autre commencement de l’état civil que celui par la violence, sur la contrainte de laquelle le droit public est ensuite fondé. » (VIII,371 15-17)[2]
[1] Premier appendice de la Paix perpétuelle : XI,229 ; trad. de Fr. Proust, GF Flammarion, 1991, p.110 ; Ak. VIII,370 (Politik als ausübende Rechtslehre). Toutes les traductions sont de mon fait (*CF).
[2] Ibid., XI,231/fr.111, Ak. VIII,371 (durch Gewalt).
« Un État peut également se gouverner déjà de manière républicaine, bien qu’il possède encore, d’après la Constitution en place, une souveraineté despotique : jusqu’à ce que le peuple devienne peu à peu capable d’être influencé par la seule idée de l’autorité de la loi (comme si elle possédait un pouvoir physique) et soit par suite reconnu capable de se donner sa propre législation (qui est fondée originairement sur le droit). Même si, par la turbulence d’une révolution provoquée par une mauvaise constitution, d’une manière non conforme au droit une constitution plus conforme à la loi était obtenue, alors il ne faudrait plus pourtant qu’il soit tenu pour permis ensuite de ramener le peuple à nouveau à l’ancienne. » (VIII,372 28-37)
« Ce sont des lois permissives de la raison : laisser perdurer l’état d’un droit public entaché d’injustice aussi longtemps jusqu’à ce qu’en vue du bouleversement complet tout ait mûri de soi-même, ou bien ait été rapproché de la maturité par des moyens pacifiques. Car n’importe quelle constitution juridique, même si sa conformité au droit ne l’est qu’à un degré moindre, est préférable à l’absence de constitution : ce destin (de l’anarchie) que rencontrerait une réforme précipitée. La sagesse de l’État, dans l’état où les choses sont à présent, se reconnaîtra donc pour devoir de faire des réformes appropriées à l’idéal du droit public : et là où la nature a produit d’elle-même des révolutions, de les utiliser non pour embellir une oppression encore plus grande, mais comme un appel de la nature pour mettre en place, par une réforme de fond, une constitution légale fondée sur des principes de liberté comme la seule constitution durable. » (VIII,373 27-38) [3]
« C’est donc bien possible que les moralistes despotisants (manquant d’application) transgressent de multiples manières (par des mesures prises ou prônées précipitamment) la prudence d’État, il faut bien pourtant que l’expérience, lors de leur transgression contre la nature, les amène peu à peu dans une meilleure voie. » (VIII,373 8-12)
[3] Note du premier appendice de la Paix perpétuelle (1795) : XI,234/fr.114, Ak. VIII,373 (gründliche Reform).
fiat iustitia pereat mundus
Pour Kant, l’injustice (Ungerechtigkeit) n’est rien d’autre que la violation ou négation du droit (Unrecht). Le droit (ius) ayant pour fonction de faire régner la justice (iustitia), la politique a pour but de mettre fin à l’injustice sur terre : « Il faut que le droit et la justice soient dans le monde[1]. » C’est une nécessité, car un monde sans droit (dikè) ni justice (themis) ne serait plus à proprement parler un monde (cosmos). Mais cette nécessité détermine un impératif, catégorique, qui ne souffre aucune casuistique : fiat iustitia pereat mundus.
Si Kant invoque cette formule proverbiale dans la Paix perpétuelle, ce ne peut être pour soutenir en toute contradiction que la fin justifie les moyens : il ne s’agit pas d’imposer le règne de la justice à tout prix, mais d’affirmer que la justice est une valeur au-dessus d’un monde impensable dans justice. Kant réfuterait par avance la critique wébérienne d’une éthique de la conviction assez intransigeante pour vouloir la justice au risque de voir périr le monde : la fin du monde n’est pas le prix à payer pour la fin de l’injustice. En atteste la traduction proposée par Kant qui atténue la sentence latine en substituant à l’effondrement du monde l’anéantissement de tous les scélérats dans le monde : « le monde ne s’effondrera aucunement du fait qu’il y aura moins d’hommes mauvais[2] » (dans le monde). Kant considère cet aphorisme comme une « proposition vraie » qui permet de récuser tout calcul d’intérêts en matière morale : c’est un principe de droit qui enjoint d’aller droit au but et coupe ainsi court à toute courbure du droit en obstruant toutes les voies tortueuses ou sinueuses que la ruse ou la violence tracent par avance pour détourner du droit chemin[3]. Il n’est donc aucunement nécessaire d’accepter en principe des injustices comme prix à payer pour le règne du droit et de la justice dans le monde. Encore faut-il expliquer comment cela est possible. C’est même pour Kant le problème politique par excellence : comment mettre fin à l’injustice sans commettre d’injustice ?
[1] Réflexion n° 7683 sur la philosophie du droit [1772-75 ou 1776-78] : Ak. XIX,489.
[2] Premier appendice de la Paix perpétuelle (1795) : XI,242, Ak. VIII,379. VIII, 352. Trad. fr. par F. Proust, GF, 1991, p. 121.
[3] Ibid., XI,241-242/fr.120-121, Ak. VIII,378-379 (krumme Wege).
une critique du droit de rébellion
C’est la rupture de la chaîne du droit établi en raison de la césure révolutionnaire et, donc, la réapparition du status naturalis qui pousse Kant à juger que « toute amélioration de l’État par la révolution est injuste » (unrecht) et que la religion protestante qui conteste une autorité usurpée ne peut être appelée réformée[1]. Dans les deux cas, on a affaire à une césure révolutionnaire qui n’est pas une simple réforme au sens d’une transformation : ce sont des faits historico-politiques qui ne peuvent être justifiés d’un point de vue juridico-politique. Néanmoins, Kant éprouve de l’enthousiasme pour la Révolution et approuve tout autant la Réforme luthérienne. Cela ressemble à un paradoxe qui confine à la contradiction : Kant affirme qu’il est « de tout temps injuste » de procéder par le moyen de la révolution dans le texte même où il déclare son accord avec la Révolution[2]. Cela invite à quelque prudence quant à l’interprétation du terme unrecht qui est employé également dans le passage de la Paix perpétuelle où Kant semble en toute contradiction avaliser le fait accompli de la Révolution française :
Même si, par la turbulence d’une révolution provoquée par une mauvaise constitution, d’une manière non conforme au droit [unrechtmäßigerweise] une constitution plus conforme à la loi [gesetzmäßigere] était conquise, alors il ne faudrait plus pourtant qu’il soit tenu pour permis ensuite de ramener le peuple à nouveau à l’ancienne[3].
Kant reconnaît dans la révolution un procédé trouble et brutal qui renverse une mauvaise constitution d’une manière qui n’est pas conforme au droit pour la remplacer par une constitution plus conforme à l’idée du droit. La traduction de l’énoncé est au plus haut point problématique pour une raison sémantico-politique : à cette époque, le concept d’État de droit n’existe pas plus que la distinction entre légalité et légitimité qui sera ultérieurement importée en allemand. C’est comme si l’allemand de cette époque exprimait de manière inversée la distinction entre droit et loi : tout en étant illégal (non conforme au droit), le procédé révolutionnaire aurait permis de conquérir – par les armes – une constitution plus légitime (plus conforme à la loi). Cette manière de procéder n’est pas simplement illégale, c’est-à-dire en contradiction avec la loi positive (non conforme au droit établi) : elle est littéralement injuste au sens de l’absence de droit qui règne à l’état de nature. Il y a bien violation illégitime ou injuste de l’idée du droit par ce retour violent à l’état de nature qu’impose l’événement révolutionnaire : le fait révolutionnaire est en ce sens une injure faite au droit en tant que le procédé révolutionnaire ne se conforme pas à l’idée du droit. Mais, à prendre au sérieux la distinction rousseauiste entre fait et droit[4], cette manière de procéder n’est pas illégitime au sens actuel du terme.
[1] Réflexion n° 8045 sur la philosophie du droit [1785-89 ou 1790-1804] : Ak. XIX,591. Trad. fr. par F. Proust en appendice de sa traduction de Théorie et pratique, p. 137.
[2] Note du point 6 de la seconde section du Conflit des Facultés : XI,360, Ak. VII,87. Traduction par mes soins dans Le Conflit des Facultés et autres textes sur la révolution (2015).
[3] Premier appendice de la Paix perpétuelle : XI,234/fr.113, Ak. VIII,372 (conquise traduit errungen). Voir aussi le fragment du manuscrit préparatoire à la Paix perpétuelle : Ak. XXIII,188, cf. Ak. XXIII,183.
[4] Jean-Jacques Rousseau, Contrat social, liv. I, chap. ii-iii.
la révolution comme appel de la nature
à réformer profondément l’État
Au niveau politique, il faut distinguer entre le jugement normatif, qui condamne moralement la décision politique de faire une révolution, de tout temps injuste en droit, et l’énoncé descriptif, qui constate l’efficacité naturelle ou mécanique des révolutions au regard du souverain bien politique.
Acceptant la distinction erhardienne entre révolutions naturelles et artificielles, Kant adopte une position politiquement révolutionnaire qui légitime la révolution comme processus naturel donnant l’occasion historique de mettre en place la république sans pour autant se livrer à l’apologie du procédé révolutionnaire qui justifierait d’en déclencher une artificiellement[1]. L’être humain n’a aucunement le droit naturel de chercher à provoquer arbitrairement un phénomène qui doit, en droit, rester naturel et de toute façon échappe en fait tout naturellement au contrôle et au pouvoir de l’être humain. C’est pourquoi, du point de vue moral du droit, la révolution comme interruption momentanée du droit ne doit pas plus être que la guerre[2]. Il y aurait quelque impiété, une forme d’injustice donc, à vouloir de son propre chef initier le processus d’institution de la république : « L’initier est impiété », mais – ajoute Kant – « lorsque le destin l’introduit, c’est une plus grande impiété encore de ne pas le suivre[3] ». Si le destin d’une révolution s’impose providentiellement, il n’y a donc aucune injustice à saisir une opportunité qui s’est produite de manière naturelle : c’est même un devoir politique de répondre à l’appel lancé par la nature en engageant des réformes profondes du système socio-politique[4] qui accomplissent la républicanisation révolutionnaire de l’État, et c’est un droit moral de défendre par les armes la patrie de la Révolution.
Kant a employé dès 1795 le terme même qui lui sert à légitimer les conquêtes de la Révolution française en 1798 : si la constitution de droit naturel n’est « pas encore conquise par les seuls combats sauvages » (errungen), cet événement signe pourtant l’évolution dans le sens de la mise en place d’une constitution républicaine qui écarte toute manie belliqueuse[5]. Kant vient tout juste d’invoquer l’enthousiasme des acteurs de la révolution en cours pour l’idéal purement moral du droit, alors même que les « révolutionnants » sont en train de défendre le droit du peuple par les armes[6]. Le philosophe de Königsberg articule le fait naturel de la révolution et le droit politique à la réforme. La révolution est donc un moyen providentiel que la nature donne aux êtres humains de faire valoir leurs droits naturels. Kant semble ainsi avoir résolu le problème de la quadrature du cercle de l’injustice : comment y mettre fin sans injustice ?
Cette résolution kantienne qui paraît au plus haut point idéaliste, au sens négatif du terme, semble succomber à une sorte d’attentisme qui pourrait être qualifié d’opportunisme. Le problème de la sagesse politique, déclare-t-il en effet en 1795, se résout en quelque sorte de lui-même et mène directement au but qu’est la paix perpétuelle, à la condition du moins de se souvenir du précepte pragmatique de s’approcher sans cesse de ce but en fonction des circonstances favorables sans chercher à l’atteindre de manière précipitée par la violence : il suffirait donc d’aspirer au règne de la raison pure pratique et à sa justice pour qu’advienne de lui-même ce but[7]. C’est que les principes du droit public qui permettent de définir une politique a priori s’accordent d’autant mieux avec le but poursuivi que ce but matériel n’est pas mis au principe de l’action (politique). Faisant abstraction de tout principe matériel, c’est-à-dire du but de la paix perpétuelle, l’impératif catégorique en politique est purement formel : ce qui est de droit est défini par la volonté générale qui est donnée a priori (au sein d’un peuple ou dans la relation entre divers peuples). Or, c’est l’argument avancé par Kant, cette unification de la volonté de tous peut être, selon le mécanisme naturel, la cause efficiente du but à atteindre et donner ainsi de l’effectivité au concept de droit, du moins si elle est appliquée de manière conséquente : le but politique, la paix perpétuelle, serait atteint dans la mesure même où la volonté générale est produite ici et maintenant, sous les espèces de la constitution républicaine et/ou de l’alliance institutionnelle des peuples. La projection idéale du but à venir, la fin de l’injustice, ne doit donc pas détourner de faire son devoir à présent sous prétexte que l’histoire passée donne suffisamment d’exemples de l’incapacité humaine à atteindre ce but. Les « moralistes » au service du pouvoir, qui invoquent ces exemples historiques de constitutions mal organisées ou la méchanceté naturelle de l’être humain pour étayer l’impossibilité congénitale d’appliquer les principes moraux du droit, avancent une « théorie corrompue » qui produit le mal qu’elle prédit en justifiant de traiter les hommes comme des bêtes, c’est-à-dire comme des êtres naturels sans disposition morale. Il faut partir du principe inverse d’une politique morale fondée sur le devoir, et non sur la prudence, qui enjoint au peuple de s’unir selon des principes de liberté et d’égalité, c’est-à-dire de produire « l’unité collective de la volonté unifiée »[8] : c’est que l’union constitutive de la société civile est un « but en soi » et un « devoir inconditionné »[9].
C’est pourquoi on peut suivre le courageux précepte, fiat iustitia pereat mundus, qui enjoint de partir du principe de la justice, et non du but poursuivi, sans s’inquiéter des conséquences qui seront de toutes façons en accord avec le principe. Il ne s’agit donc pas pour Kant d’espérer de manière inconsidérée que le mal moral se détruise de lui-même[10]. L’espoir que donne la foi de la raison dans le progrès du genre humain en mieux a pour fonction pratique d’encourager à agir dans le bon sens[11]. Kant n’est pas le penseur idéaliste d’une justice à venir au sein d’un monde métaphysique : il pense bien la consistance naturelle du monde physique de l’injustice effective, mais il pense également la possibilité d’en sortir pour ne pas désespérer d’y rester enfermé. Loin d’être enfermé dans sa prévision du monde métaphysique, il pense le fait révolutionnaire en sa condition de possibilité factuelle. S’appuyant sur son diagnostic de l’époque, Kant interprète en ce sens l’événement opportun de la Révolution comme annonçant un tournant qui donne de bonnes raisons d’espérer, malgré toutes les horreurs commises à cette occasion, que le genre humain progresse en mieux, sans pour autant céder au délire messianiste[12]. Car l’illusion fatale en politique serait de prédire la fin à venir de l’injustice de façon à justifier de se précipiter sur les moyens violents de mettre fin à l’injustice une fois pour toutes. Il s’agirait au contraire de s’engager dès à présent contre l’injustice ici et maintenant tout en sachant que la lutte ne connaîtra jamais de fin.
[1] Voir mon ouvrage sur La politique de Kant – un réformisme révolutionnaire (2016), p. 454 .
[2] Conclusion de la Doctrine du droit : VIII,478-479/fr.237-238, Ak. VI,354-355.
[3] Travail préparatoire à la Métaphysique des mœurs : Ak. XXIII,247. Trad. fr. p. 255 (2015).
[4] Note de l’appendice second de la Paix perpétuelle : XI,234/fr.114, Ak. VIII,373.
[5] Point 7 du Conflit des Facultés (1798) : XI,360-361, VII,87-88. Trad. fr. par mes soins, p. 127 (2015).
[6] Point 6 du Conflit des Facultés : XI,359/fr.125-126, Ak. VII,86 (Revolutionierenden).
[7] Premier appendice de la Paix perpétuelle : XI,240-241/fr.119-120, Ak. VIII,377-378.
[8] Ibid., XI,231/fr.111, Ak. VIII,371.
[9] Début de la seconde section de Théorie et pratique : XI,144/fr.63, Ak. VIII,289.
[10] Premier appendice de la Paix perpétuelle : XI,242/fr.121, Ak. VIII,379.
[11] Troisième section de Théorie et pratique : XI,167-168/fr.87-89, Ak. VIII,309.
[12] Voir ma postface à la traduction du Conflit, p. 359-372 et p. 386-388 (2015).
II. De la compatibilité entre morale et politique